| |
| Le point sur les LCD DiversEcrans Publié le Vendredi 11 Juin 2004 par Vincent Alzieu URL: /articles/498-1/point-lcd.html Page 1 - Le point sur les LCD  Si l’on s’en tient aux grandes lignes, les écrans LCD (de l’anglais Liquid Crytals Displays pour Ecrans à Cristaux Liquides) sont les successeurs incontournables des tubes cathodiques (CRT). Pour l’heure, vous avez encore le choix entre les deux technologies. Mais ça ne va pas durer. Les plus optimistes prévoient la mort du tube dans 10 ans ; certains constructeurs (d’écrans à tube !), à notre avis plus réalistes, l’envisagent d’ici 4 ans. Ce n’est pas pour autant dramatique. Les écrans LCD ont considérablement progressé. Même s’ils ne sont pas encore parfaits, on le verra plus loin, ils apportent des avancées considérables. Si l’on s’en tient aux grandes lignes, les écrans LCD (de l’anglais Liquid Crytals Displays pour Ecrans à Cristaux Liquides) sont les successeurs incontournables des tubes cathodiques (CRT). Pour l’heure, vous avez encore le choix entre les deux technologies. Mais ça ne va pas durer. Les plus optimistes prévoient la mort du tube dans 10 ans ; certains constructeurs (d’écrans à tube !), à notre avis plus réalistes, l’envisagent d’ici 4 ans. Ce n’est pas pour autant dramatique. Les écrans LCD ont considérablement progressé. Même s’ils ne sont pas encore parfaits, on le verra plus loin, ils apportent des avancées considérables.Les bons points du LCD Quelques généralités pour commencer. Compacts et légers, les LCD sont trois fois moins volumineux et consomment quatre fois moins d’énergie que les moniteurs traditionnels. Ils sont indifférents aux interférences (radio, portable, TV…), la géométrie des images est parfaite, la durée de vie des écrans est deux fois plus longue que celle des tubes et, surtout, ils sont plus reposants pour les yeux. Pour vous en convaincre, tentez une petite expérience simple. Remplacez votre tube par un écran plat pendant deux semaines. Passé ce délai, remettez votre tube. A coup sur, sauf sur quelques très bons écrans, vous vous demanderez comment vous avez pu supporter une telle image pendant des années. Dans la plupart des cas l’image du tube paraîtra floue, les couleurs fades, la luminosité insuffisante. De tous, le défaut le plus gênant des tubes est sans doute la perte de netteté avec le temps. Cette perte progressive couplée avec le scintillement et le rayonnement de l’écran fatiguent. De ce point de vue au moins, l’arrivée des écrans plats est déjà un progrès extrêmement appréciable. Les défauts des plats Pour autant, le monde du LCD n’est pas tout rose. Même si leur prix a chuté des deux tiers en deux ans, ils restent deux fois plus chers que les écrans à tube. De plus, alors qu’on peut passer indifféremment d’une résolution à l’autre sur les moniteurs cathodique, celle des LCD est fixe. Les LCD 15 pouces travaillent en 1024 x 768 pixels, les 17 et 19 pouces en 1280 x 1024, les 20 pouces et plus généralement en 1600 x 1200. Il est possible de sortir du mode optimal, mais ce sera toujours au détriment de la qualité d’image. Très nette à la résolution native, l’image sera floue dans les autres modes. Enfin, les écrans à tube restent plus rapides que les cristaux liquides. Cela se voit dans les jeux, dans les films. Il est courant de percevoir un léger flou dans les mouvements sur les écrans plats. Page 2 - Comprendre : la construction, un Légo 2 pièces Comprendre : la construction, un Légo 2 piècesPour construire leurs écrans, les constructeurs se contentent à peu de choses près de coupler une coque avec le principal composant de ces écrans, une dalle.  La dalle se présente sous la forme d’un rectangle de 1 à 2 centimètres d’épaisseur, avec d’un côté la surface d’affichage de l’écran, de l’autre une carte électronique. Entre les deux, renfermés, on trouve 2 à 12 néons chargés du rétro éclairage, des cristaux liquides par lesquels transite la lumière et des filtres de couleur. Le schéma est le suivant : les néons émettent de la lumière blanche. Cette lumière arrive et cherche à traverser les cellules de cristaux liquides sur leur chemin. Ces cellules de cristaux liquides, trois par pixel, sont pilotées par un transistor, lui-même commandé par la carte mère au dos de l’écran. A chaque tension émise par le transistor correspond une position des cristaux. 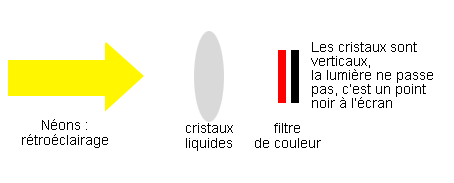 S’ils se placent à la verticale, la lumière des néons est bloquée, c’est un point noir à l’écran. 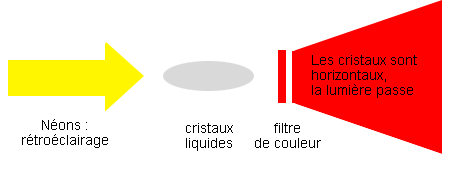 S’ils sont horizontaux, toute la lumière passe, le point sera blanc. Plaçons nous maintenant au niveau des pixels. Chaque pixel est composé de trois cellules voisines pleines de cristaux liquides, avec devant chacune un filtre rouge, vert ou bleu. Si les cristaux prennent une position horizontale, toute la lumière passe. La première cellule émet une lumière rouge, la seconde verte, la troisième bleue. L’œil assemble ces trois points et n’en voit qu’un, blanc. C’est le principe de la lumière additive. Après, il n’y a plus qu’à appliquer des tensions différentes sur les trois cellules pour recréer toutes les couleurs disponibles. Si les transistors commandent 256 rouges, 256 bleus et 256 verts, le nombre de couleurs disponibles à l’écran sera de 256 x 256 x 256 = 16,7 millions de couleurs. Finalement, la marge de manœuvre des constructeurs d’écrans est assez réduite. Il leur faut surtout sélectionner la bonne dalle, éventuellement personnaliser l’électronique, choisir les réglages par défaut de l’écran et intégrer le tout dans une coque. Le choix de la dalle est donc primordial. De lui dépend le nombre de couleurs affichées par l’écran, ses angles de vision, la luminosité maximale disponible et la réactivité des pixels. Les constructeurs doivent viser des cristaux les plus rapides possibles. S’ils sont trop lents, l’image affichée ne sera pas en phase avec celles demandées par la carte graphique et attendues par le spectateur. Pour tout cela, les constructeurs ont à leur disposition trois technologies de dalles concurrentes et, au sein de chacun, des dizaines de modèles disponibles. Page 3 - Petit historique sur deux ans Petit historique sur deux ans  La saga LCD comporte déjà de multiples épisodes. Alliances, coups d´éclat, scandales... Un résumé des derniers opus s’impose. La saga LCD comporte déjà de multiples épisodes. Alliances, coups d´éclat, scandales... Un résumé des derniers opus s’impose.En 2001, les 15 LCD 15 pouces testés affichaient des temps de réponse de 25 à 60 ms. Contrairement à toute attente, celui qui remporta nos suffrages était un 40 ms, le Belinea 10 15 35, très modeste sur le papier, excellent (pour l’époque) lors des tests. C’était de loin le plus réactif de la bande, celui sur lequel la rémanence se faisait le moins sentir. On était encore loin de la fluidité des CRT, mais c’était le meilleur. Déjà, nous nous étions aperçu que le temps de réponse indiqué par les constructeurs n’était pas forcément représentatif de la réactivité réelle des pixels. Depuis, nous avons creusé la question. Notre impression n’était pas sans fondement. Nous expliquons plus loin pourquoi. Autrement, déjà en 2001, les écrans testés avaient recours aux trois technologies de dalles existantes : TN, IPS, VA. Ces trois technologie restent d´actualité mais les prévisions passées se sont révélées fausses. Les constructeurs pariaient à l´époque sur la disparition de la technologie d´entrée de gamme, TN, au profit de l´IPS et du VA dont les angles de vision sont plus larges. Retournement de situation, le TN a aujourd´hui les faveurs de tous. C´est la seule technologie vraiment rapide, capable d´afficher correctement les jeux rapides. Page 4 - IPS, VA, TN IPS, VA, TNIPS, In Plane Switching  Depuis 2001, la technologie IPS a peu ou pas évolué. Même si les caractéristiques de ces moniteurs sont chaque année plus alléchantes (certains modèles affichent un temps de réponse de 16 ms), dans la pratique ces écrans restent les moins réactifs, ceux sur lesquels les jeux rendent le moins bien. L’effet de flou y est toujours nettement plus sensibles que sur les écrans VA et TN. Depuis 2001, la technologie IPS a peu ou pas évolué. Même si les caractéristiques de ces moniteurs sont chaque année plus alléchantes (certains modèles affichent un temps de réponse de 16 ms), dans la pratique ces écrans restent les moins réactifs, ceux sur lesquels les jeux rendent le moins bien. L’effet de flou y est toujours nettement plus sensibles que sur les écrans VA et TN.A moins peut-être de monter sur des écrans très hauts de gamme de la dernière génération (comme le Nec 2080UX+, que nous venons de recevoir mais que nous n’avons pas encore eu le temps de tester), ces écrans ne sont pas les mieux adaptés à un usage ludique. Les TN et les VA rendent mieux les jeux et les films, pour moins cher. Le rendu des couleurs s’est un peu amélioré en deux ans, mais à nouveau moins vite que sur les écrans TN et VA. On leur reconnaît tout de même un rendu des couleurs très satisfaisant, des angles de vision assez larges et, parce que cette technologie est souvent implémentée dans des écrans hauts de gammes, les moniteurs qui y recourent bénéficient souvent d’ergonomies remarquables. Reste qu’en deux ans on a tout de même le sentiment que la technologie IPS a stagné. Toutefois, après l’IPS, le Super-IPS, l’Advanced-IPS, une nouvelle génération de dalle arrive : le Super Advanced-IPS. Serait-ce la bonne ? Réponse d’ici peu. VA, Vertical Alignment  La technologie VA a été initiée par Fujitsu Siemens sous l’appellation MVA. On la trouve désormais également sous l’étiquette PVA chez Samsung, ASV chez Sharp et Super MVA chez CMO. En 2001, le temps de réponse de ces écrans était de 25 ms, il est aujourd’hui de… 25 ms. Sauf sur un seul écran, le SyncMaster 193P de Samsung. C’est le premier VA 20 ms. La réactivité est effectivement un peu meilleure que sur les VA 25 ms, mais des progrès sont encore nécessaires. Les écrans TN demeurent nettement plus réactifs. La technologie VA a été initiée par Fujitsu Siemens sous l’appellation MVA. On la trouve désormais également sous l’étiquette PVA chez Samsung, ASV chez Sharp et Super MVA chez CMO. En 2001, le temps de réponse de ces écrans était de 25 ms, il est aujourd’hui de… 25 ms. Sauf sur un seul écran, le SyncMaster 193P de Samsung. C’est le premier VA 20 ms. La réactivité est effectivement un peu meilleure que sur les VA 25 ms, mais des progrès sont encore nécessaires. Les écrans TN demeurent nettement plus réactifs.Les VA l’emportent en revanche sur les TN dans la plupart des autres sujets. Le rendu du noir est souvent meilleur, les angles de vision sont aussi larges que ceux des TN sont réduits, les couleurs sont plus fidèles. Tout simplement, ces écrans affichent vraiment 16,7 millions de couleurs, les TN non. TN, Twisted Nematic  Présente dans les écrans d’entrée et milieu de gamme, la technologie TN a gagné ses lettres de noblesse au fil des avancées techniques. Et elles ont été beaucoup plus nombreuses en deux ans que sur les écrans IPS et VA. Présente dans les écrans d’entrée et milieu de gamme, la technologie TN a gagné ses lettres de noblesse au fil des avancées techniques. Et elles ont été beaucoup plus nombreuses en deux ans que sur les écrans IPS et VA.Sans atteindre les angles de vision des technologies rivales, ceux des TN se sont élargis. Autre progrès, la toute dernière génération de dalle (temps de réponse de 12 ms) réussit enfin à produire un noir très convaincant. Mais surtout, indépendamment des caractéristiques, le temps de réponse des cristaux est sensiblement plus rapide sur les écrans IPS et VA. Toutefois, on se trouve encore aujourd’hui dans une situation comparable à celle de 2001 : la dalle TN la plus rapide de toutes dans les tests est une 20 ms, alors qu’il existe des dalles 12 ms. Cette dalle commence même à dater. Signée d’un constructeur coréen, BOE-Hydis, on l’a successivement trouvée dans le AS4314-UTG de Iiyama, dans le ProphetView 920 Pro de Hercules, dans le AL1731 de Acer… Page 5 - Comprendre : le temps de réponse Comprendre : le temps de réponseLa lecture des caractéristiques d’un écran prend peu de temps. D’autant que, comme vous le lirez ci-dessous, la côte de confiance qu’il faut leur accorder est très limitée.  Le temps de réponse est la première caractéristique des LCD. Exprimé en millisecondes, ce temps est celui nécessaire pour qu’un pixel passe du blanc au noir, puis revienne au blanc. Les écrans testés il y a deux ans affichaient des temps de 60 à 25 millisecondes (ms) pour les plus rapides. Aujourd’hui, les écrans descendent à 12 ms. Et il est déjà question de moniteurs 8 ms en septembre prochain. Théoriquement, plus ce temps est rapide, plus les mouvements à l’écran sont fluides, nets. Ce serait effectivement le cas si ce temps de réponse était constant, valable pour tous les changements de couleur. C’est loin d’être le cas. Un écran 25 ms blanc / noir / blanc peut très bien nécessiter 120 ms pour faire gris clair / gris foncé / gris clair. Explications La mesure du temps de réponse, comme le reste des caractéristiques des LCD, est définie par une norme ISO, la 13406-2. On va le voir ici, on y reviendra encore plus tard : cette norme mérite d’être vite revue en profondeur ! Pour passer du blanc au noir, la tension appliquée aux cellules passe de 0 au maximum. Très stimulés, les cristaux s’orientent rapidement. Le temps mis pour aller du blanc au noir est appelé temps de montée. Pour revenir au blanc, on coupe la tension. Les cristaux reviennent à leur position d’origine facilement, rapidement. On parle de temps de descente. Le temps de réponse est l’addition des temps de montée et de descente. Premier bémol introduit par la norme ISO : la mesure des temps de montée et de descente ne se fait pas sur la totalité des signaux, mais sur 80 %. Les 10 % à chaque extrême sont tronqués. Cette mesure, certes justifiable, simplifie et flatte les mesures. Elle les fausse aussi car si certains systèmes mettent plus de temps que d’autres à décoller ou à se stabiliser, on ne le verra pas. 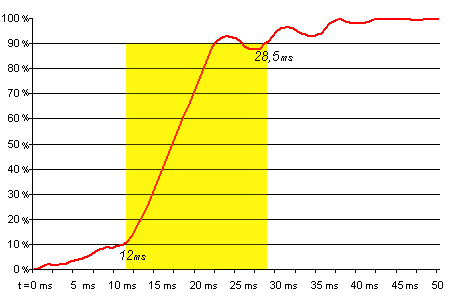 Dans l´exemple précédent, le temps de montée serait de 28,5 - 12 = 16,5 ms. Pourtant, il serait logique de considérer qu´il approche plutôt les 40 ms dans la réalité... Vient ensuite le problème des temps de réponse entre couleurs. Pour passer du gris clair au gris foncé, on passe d’une tension peu élevée mais non nulle, à une autre assez forte. La stimulation est sensible, mais nettement moins forte que quand on passe de 0 à MAX. Les cristaux sont donc plus lents à se mouvoir. Dans la pratique, le temps de montée devient plus lent. Pour revenir au gris clair, c’est le schéma inverse. A nouveau, les cristaux mettront plus de temps à retrouver leur état initial que si l’on coupe complètement la tension. Le temps de descente est donc lui aussi plus lent. Pour l’instant, la norme ISO en vigueur n’oblige pas les constructeurs à prendre en compte les temps de réponse intermédiaires. On se retrouve avec des écrans de technologie différentes, avec des cristaux plus ou moins rapides au sein de mêmes familles et, pourtant, des temps de réponse communiqués identiques. On se trouve dans une situation où, par exemple, les écrans équipés de dalles TN de marque AU Optronics 16 ms sont un peu plus rapides que les LG-Philips 16 ms et que les Samsung 12 ms. Elles sont également nettement plus réactives que les dalles IPS 16 ms tout en étant plus lentes que les TN 20 ms de Hydis. Comment le consommateur peut-il s’y retrouver ? Vivement que cette norme ISO 13406-2 soit mise à jour ! (une fois) Page 6 - Comprendre : luminosité et taux de contraste Comprendre : luminosité et taux de contrasteLe taux de contraste se mesure en opposant le point le plus lumineux produit avec celui le plus sombre. Pour obtenir, un bon taux de contraste, il faut avoir le blanc le plus blanc, et le noir le plus noir. Appareil de mesure en main, il faut donc mesurer le niveau du blanc. Mettons qu’il soit de 250 cd/m². Mesure ensuite du noir, admettons qu’il soit de 0,5 cd/m². La formule pour établir un taux de contraste est la suivante : Blanc / noir = taux de contraste. Appliquée à notre cas, cela donne : 250 / 0,5 = 500 : 1. Ce sont des mesures typiques d’écrans plats. Maintenant, il est tentant pour un constructeur de faire sortir son écran du lot en proposant un taux de contraste plus fort encore. Pour y arriver, il a deux possibilités. Soit il améliore son noir, ce qui est assez difficile. Il faut améliorer les filtres posés sur la dalle et mieux couper la source lumineuse en contrôlant mieux le déplacement des cristaux liquides pour qu’ils soient plus encore à la verticale du champ lumineux. Ou alors il pousse la lumière dans le blanc. Pour ce faire, il suffit de rajouter des néons ou tout simplement de les remplacer par des plus lumineux. Dans ce cas, son blanc pourrait bien atteindre les 500 cd/m². Si l’on reprend notre formule, son nouveau taux de contraste sera de : 500 / 0,5 = 1000 : 1. Avec un tel taux de contraste, cet écran pourrait être vu comme idéal pour les graphistes, souvent sensibles à ce paramètre. Sauf qu’en fait il sera juste plus lumineux que les autres, ce qui cette fois est un défaut. En réalité, la luminosité préconisée sur un LCD n’excède pas 110 cd/m². Sur les écrans à tube, elle n’est même que de 90 cd/m². Tous les écrans à 250 cd/m² (ils sont presque tous réglés ainsi) sont donc trop lumineux. C’est gênant et fatigant. Vous en viendrez à coup sur à diminuer manuellement la luminosité. En conclusion, les taux de contraste sont mesurés actuellement dans des conditions non représentatives d’une utilisation normale. Pour avoir de la valeur, cette mesure devrait être effectuée avec le même niveau de blanc pour tous les écrans, 110 cd/m² par exemple. Espérons que la mise à jour de la norme ISO attendue intègre une obligation de ce type. D’ici là, ne jetez qu’un œil distrait sur cette caractéristique… Vivement que cette norme ISO 13406-2 soit mise à jour ! (deuxième fois) Page 7 - Comprendre : les angles de vision Comprendre : les angles de visionEn fonction de leur technologie, les angles de vision varient de 140° (TN) à 176° (VA), et 160° pour les IPS. C’est peut-être la seule caractéristique à laquelle vous pourrez vous fier, au moins en partie. En effet, les écrans TN bénéficient d’angles de vision nettement plus réduits sur les IPS, eux-mêmes un peu moins ouverts que les VA. Cela ne veut pas dire pour autant que vous pouvez prendre cette caractéristique pour argent comptant. 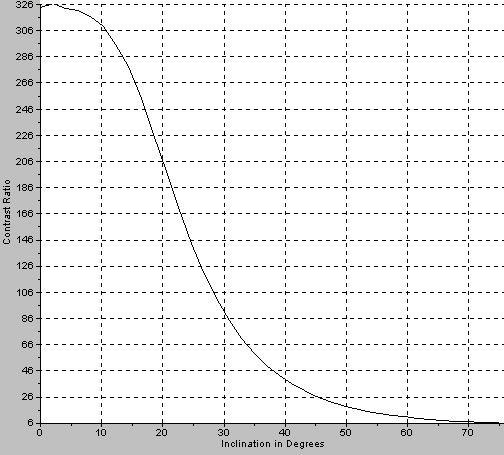 L’angle de vision peut être établi dans deux conditions différentes. Le constructeur peut choisir de retenir l’angle jusqu’auquel l’utilisateur bénéficie d’un contraste de 10 : 1, ou celui ou le contraste tombe à 5 : 1. Dans le premier cas, l’image à 10 : 1 est mauvaise, dans l’autre, elle est très mauvaise. En aucun cas vous n’aurez une belle image si vous la voyez de l’angle maximal recommandé. C’est notamment sur ce point que les futurs écrans OLED apporteront de vraies améliorations. Les prototypes testés offrent des angles de vision totaux. Même à la verticale de l’image les couleurs restent vives. Page 8 - Comprendre : 16,7 ou 16,2 millions de couleurs ? Comprendre : 16,7 ou 16,2 millions de couleurs ?Tous les écrans revendiquent afficher 16 millions de couleurs. Toutefois, le chiffre après la virgule change. Dans un cas, c’est 2, dans l’autre c’est mieux, c’est 7. En principe, les écrans peuvent afficher 256 nuances de rouge, 256 bleus, 256 verts. La combinaison des trois permet de restituer 16,7 millions de nuances. C’est ce que font les écrans VA et IPS. Les écrans TN sont plus économiques. En fait, ils ne connaissent que 64 rouges, 64 bleus, 64 verts. Soit à la base 262 144 couleurs. Pour atteindre quand même les 16 millions de couleurs, ces moniteurs font appel à un dithering. Les constructeurs affichent rapidement deux couleurs très proches, si vite que votre œil n’en voit qu’une. Au lieu de connaître toutes les nuances 0, 1, 2, 3, et ainsi de suite jusqu’à 255, les écrans TN connaissent les états 0, 4, 8, et tous les multiples de 4 jusqu’à 252. Pour afficher la couleur 2 Les constructeurs ont plusieurs possibilités. S’ils veulent travailler sur un pixel seulement, au temps initial (T0), le pixel est blanc (couleur 0). A T1, le pixel passe à la couleur 4. Puis retour en T2 à blanc (0), 4 en T3 et ainsi de suite. L’œil voit une moyenne des deux couleurs successives, la couleur 2.
L’inconvénient de cette méthode est qu’elle nécessite deux temps pour afficher la bonne couleur. Il peut donc être préférable de jouer sur quatre pixels voisins, en carré. Deux d’entre eux seront à 0, les deux autres à 4. De loin, vous verrez la couleur 2. 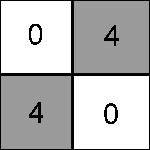 Pour afficher la couleur 1 Si l’on reprend la première méthode, à T0, le pixel est blanc. S’il l’est encore à T1, à T2 et qu’il passe à 4 à T3, l’œil verra (0 + 0 + 0 + 4) / 4 = la couleur 1. Mais il faudra 3 temps pour y arriver. C’est trop long.
A nouveau, la seconde méthode permet d’y arriver en un seul temps, en plaçant l’un des pixels à 4, et ses trois voisins à 0. 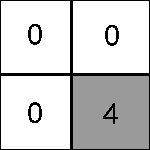 Cette méthode est très efficace. Elle a tout de même deux défauts : un scintillement peut être perceptible et on ne peut pas dépasser la couleur 252. De tels écrans sont incapables d’afficher les couleurs 253, 254 et 255. Avec le dithering, ils affichent toutes les nuances de 0 à 252, soit 253 teintes. 253 rouges x 253 bleus x 253 verts = 16,2 millions de couleurs. Page 9 - Comprendre : les pixels morts Comprendre : les pixels morts  C’est assez étonnant, les constructeurs se réservent le droit de vous vendre des écrans défectueux. Et vous ne pourrez souvent rien y redire. Ça va ressembler à de l’acharnement de notre part, mais s’ils bénéficient d’une telle impunité, c’est une fois de plus grâce... à la norme ISO 13406-2. C’est assez étonnant, les constructeurs se réservent le droit de vous vendre des écrans défectueux. Et vous ne pourrez souvent rien y redire. Ça va ressembler à de l’acharnement de notre part, mais s’ils bénéficient d’une telle impunité, c’est une fois de plus grâce... à la norme ISO 13406-2.La norme ISO 13406-2 définit 4 classes d´écrans. La plus stricte, la classe 1, n´autorise aucun défaut. C´est ce qui se fait de mieux. La pire, la "Class 4", autorise jusqu´à 549 défauts sur un écran 15 pouces, et 1 344 pixels et sous-pixels défectueux sur un 20 pouces ! Heureusement, aucun constructeur n´y fait référence. Presque tous les constructeurs se sont basés sur la Class 2 pour définir leurs conditions de garanties. En plus de cette histoire de classe, il faut aussi distinguer trois types de défauts. Il y a les pixels blancs permanents, les pixels noirs et ceux de couleur (rouge, vert, bleu). Si l’on s’y fie à la norme, au petit calcul qu’elle propose, voici les tolérances par tailles d’écran : 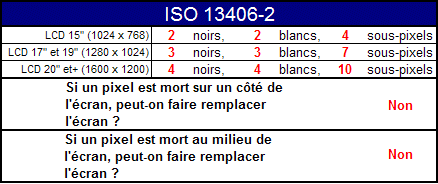 Cas pratique : si votre écran 17 pouces a 2 pixels morts blancs, 2 pixels noirs et 5 colorés, le constructeur est en principe en droit de refuser de faire jouer la garantie. Maintenant, certains constructeurs pratiquent des politiques compréhensives. Il arrive même qu’ils acceptent un remplacement pour un seul pixel mort, s’il est placé à un endroit gênant (au milieu par exemple). Renseignez vous auprès du vendeur pour savoir quels seront vos recours possibles en cas de pixels défectueux. Idéalement, essayez même de faire allumer l’écran devant vous. Ultime solution : acheter votre écran dans un magasin qui pratique le satisfait ou remboursé. C’est le cas de certaines grandes enseignes. Autrement, les vendeurs en ligne sont obligés par la loi de le pratiquer pendant 7 jours après réception du produit. On y revient : vivement que cette norme ISO 13406-2 soit mise à jour ! (3ème fois) Page 10 - Les progrès attendus, les nouvelles technologies Les progrès attendus, les nouvelles technologiesFin juillet arriveront les premiers écrans plats 17 pouces en dalles 10 ms. Ils devraient être suivis dès la rentrée de nouveaux moniteurs 8 ms. Les 19 pouces accusent toujours un temps de retard. Les premiers 12 ms arrivent seulement maintenant et ne deviendront vraiment courants qu’en septembre. Cette accélération des temps de réponse s’accompagne de la pose de filtres plus efficaces sur les écrans. Ils permettent d’une part de mieux capter la lumière diffuse (les couleurs affichées sont plus éclatantes et les noirs plus profonds), d’autre part d’augmenter les angles de vision (même s’ils demeurent toujours trop réduits à ce jour sur les écrans d’entrée de gamme). Pour ce qui est des prix, les nouvelles ne sont guère réjouissantes. Après une baisse spectaculaire en 2003, les prix ont repris jusqu’à 30 % de novembre à mai 2004. Nous connaissons actuellement une période de stabilisation mais les constructeurs annoncent déjà de nouvelles hausses dès août. Ces hausses sont dues aux succès des dalles LCD, sous toutes leurs formes. On en trouve dans les écrans, certes, mais aussi dans les ordinateurs portables et dans les TV LCD, deux secteurs qui voient leurs ventes exploser depuis un an.  Maintenant, le LCD ne sera pas l’écran ultime que connaîtront les générations après nous. Son premier remplaçant arrive dès cet été chez Nec. Son petit nom : Lumileds. Son prix : 7500 euros l’écran 20 pouces. Signe particulier : les néons dans l’écran ont disparu. Ils cèdent leur place à une matrice de 48 diodes. Dans la pratique, le noir gagne encore en profondeur et la luminosité devient plus homogène. Les zones autrefois proches des néons sont aussi lumineuses que les plus éloignées. Globalement, le rendu des couleurs est donc plus fidèle. Cette technologie, hors de prix aujourd’hui, vise les graphistes très exigeants. Maintenant, le LCD ne sera pas l’écran ultime que connaîtront les générations après nous. Son premier remplaçant arrive dès cet été chez Nec. Son petit nom : Lumileds. Son prix : 7500 euros l’écran 20 pouces. Signe particulier : les néons dans l’écran ont disparu. Ils cèdent leur place à une matrice de 48 diodes. Dans la pratique, le noir gagne encore en profondeur et la luminosité devient plus homogène. Les zones autrefois proches des néons sont aussi lumineuses que les plus éloignées. Globalement, le rendu des couleurs est donc plus fidèle. Cette technologie, hors de prix aujourd’hui, vise les graphistes très exigeants.Plus tard encore arriveront les écrans OLED. Sony, Kodak, Epson, Toshiba en sont les plus fervents défenseurs. Les diodes ne font plus que remplacer les néons à l’arrière des écrans, elles remplacent également les cellules de cristaux liquides. On n’en trouve donc plus 48 comme dans les Lumileds, mais 3 (rouge, vert, bleu) x 1024 x 768 sur un écran 15 pouces, soit 2 359 296 diodes ! Sur les 17 et 19 pouces, on monte à près de 4 millions de diodes, et presque 6 millions sur les 20 pouces.  Les premiers écrans OLED sont d´ores et déjà disponibles, mais sur de très petites tailles. On en trouve sur certains téléphones portables et sur quelques lecteurs MP3. Pour les écrans d’ordinateurs et les téléviseurs, il n’en est pour l’instant pas question avant 2007. Le plus grand prototype dévoilé à ce jour a été présenté le mois dernier par Epson. Il mesurait 40 pouces (1 mètre 02) de diagonale.  Pour ce qui est des très grandes tailles, les LCD titillent désormais les Plasma sur le terrain des téléviseurs. Alors que les Plasma ont ce défaut de perdre leur gaz très rapidement (leur luminosité baisse de moitié en deux ans s’ils sont allumés en permanence), les LCD présentent l’avantage d’être plus endurants. Revers de la médaille : ils sont aussi plus chers. A titre informatif, les plus grands de chaque technologie que nous connaissons sont signés Samsung. Ils mesurent respectivement 57 pouces (1 mètre 45) de diagonale pour le LCD, et 80 pouces (2 mètres 03) pour le plasma. Pour ce qui est des très grandes tailles, les LCD titillent désormais les Plasma sur le terrain des téléviseurs. Alors que les Plasma ont ce défaut de perdre leur gaz très rapidement (leur luminosité baisse de moitié en deux ans s’ils sont allumés en permanence), les LCD présentent l’avantage d’être plus endurants. Revers de la médaille : ils sont aussi plus chers. A titre informatif, les plus grands de chaque technologie que nous connaissons sont signés Samsung. Ils mesurent respectivement 57 pouces (1 mètre 45) de diagonale pour le LCD, et 80 pouces (2 mètres 03) pour le plasma.Copyright © 1997-2025 HardWare.fr. Tous droits réservés. |